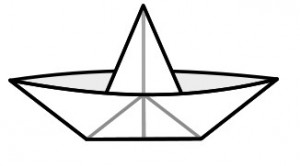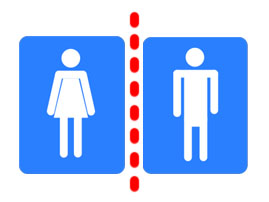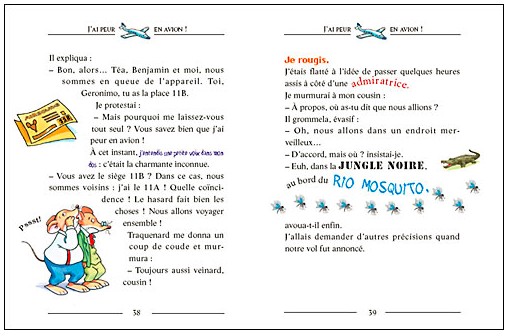Dans Anathem (Neal Stephenson), que je viens tout juste de terminer, il y a un moment où l’action devient invraisemblable. Les personnages principaux sont envoyés pour une mission, et le lecteur ne peut s’empêcher de penser qu’il devait y avoir, sur la planète, des centaines de personnes mieux qualifiées pour cette mission. Évidemment, pour les besoins de l’histoire, les personnages principaux devaient s’y coller. Que fait un auteur chevronné devant un tel problème? Est-ce qu’il ferme les yeux en espérant que les lecteurs ne se rendront compte de rien? C’est risqué! Mieux vaut avouer sa faiblesse discrètement.
Dans Anathem (Neal Stephenson), que je viens tout juste de terminer, il y a un moment où l’action devient invraisemblable. Les personnages principaux sont envoyés pour une mission, et le lecteur ne peut s’empêcher de penser qu’il devait y avoir, sur la planète, des centaines de personnes mieux qualifiées pour cette mission. Évidemment, pour les besoins de l’histoire, les personnages principaux devaient s’y coller. Que fait un auteur chevronné devant un tel problème? Est-ce qu’il ferme les yeux en espérant que les lecteurs ne se rendront compte de rien? C’est risqué! Mieux vaut avouer sa faiblesse discrètement.
C’est certainement ce qu’à fait Stephenson. Ainsi, le héros demande à un de ses contacts pourquoi diables ils ont été envoyés alors que d’autres auraient certainement mieux fait l’affaire. L’autre explique le choix, mais sa justification importe peu. À sa manière, l’auteur nous a déjà avoué : « je sais, c’est pas tout à fait naturel. »
Il m’est arrivé la même chose dans le tome trois de Terra Incognita. Cette fois-ci, c’était une répétition. Un personnage se retrouvait en prison pour la deuxième fois en deux romans. Lorsque je m’en suis rendu compte, il était trop tard pour changer la scène. J’ai donc plutôt ajouté la chose suivante :
Aldebert, qui vient à peine de terminer une longue peine dans une prison pirate, s’étend sur la paillasse comme un habitué.
— J’ai un vague sentiment de déjà vu ! s’exclame-t-il en fermant les yeux.
La phrase est un aveu: « Je sais, c’est répétitif, je m’en suis rendu compte et je m’en excuse. » Évidemment, ça ne change rien à la faute, mais au moins les lecteurs sauront que nous sommes assez intelligents pour avoir remarqué le problème, et qu’on ne les prend pas pour des imbéciles, puisque nous n’avons pas essayé de « leur en passer une » en douce. Après tout, ne dit-on pas que faute avouée, à moitié pardonnée?