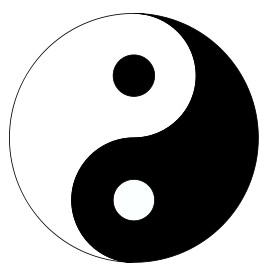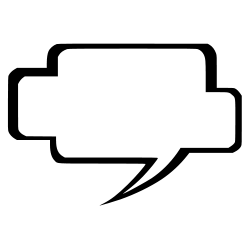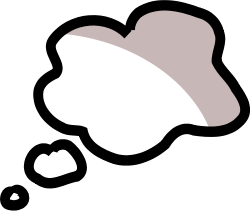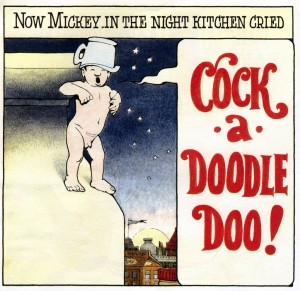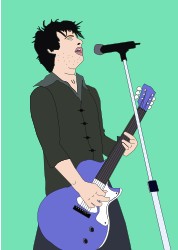Je viens de terminer la première phase de direction littéraire pour Victor Cordi, et en voici la démarche, décortiquée en 12 émotions.
1- L’impatience
Non que je sois particulièrement pressée, de faire des corrections, mais à ce stade-là, une seule personne autre que moi a lu ce roman, et j’ai super hâte de savoir ce qu’une troisième personne en pensera.
Elle tarde…
2- L’angoisse
… et je me mets à m’inquiéter que la directrice a détesté et ne sais pas comment me le dire.
Les corrections arrivent.
3- La joie
Elles sont accompagnées d’un courriel très positif. Fiou, mon premier jet n’est pas une catastrophe!
J’ouvre le document
4- La déprime
Il y a du rouge partout! Des millions de commentaires s’alignent sur la marge de droite. Soupir.
Je commence à lire le tout.
5- Le soulagement
Je réalise que 80% du rouge en question sont en fait des demandes de modifications mineures : retrait d’adverbe, ajout de synonymes, précision inutile, etc.
Je lis toutes les demandes d’une traite, puis commence le travail de modification.
Les émotions se succèdent.
6- La honte
Quoi? J’ai laissé passé une erreur aussi grossière, moi?
7- La frustration
Zut, je pensais avoir réussi à camoufler cette faiblesse de l’intrigue! Back to the drawing board!
8- L’embarras
Oups, mon premier lecteur m’avait demandé cette même modification, et je l’avais volontairement ignoré…
J’arrive à la dernière page.
9- La satisfaction
Voilà! Travail accompli!
Je considère la prochaine étape.
10- La paresse
Je ne suis pas vraiment obligée de le relire… dans le fond… c’était juste des petites modifications…
11- Le bottage de fesse
ABSOLUMENT il faut le relire! Allez, au travail! Les modifications mineures introduisent parfois de nouvelles erreurs auxquelles on n’avait pas pensé! (Notez qu’ici, une bonne directrice littéraire mentionnerait que le bottage de fesse n’est pas une émotion).
Après relecture.
12 – Le bonheur
Mais c’est qu’il est très bon ce roman! Meilleur encore qu’il ne l’était au premier jet! Yé!!!!!!!
Et c’est terminé… jusqu’à la prochaine fois!