Cette semaine, la grille des tarifs de l’UNEQ (Union des écrivaines et des écrivains du Québec) s’est promenée sur Facebook. Je suis retournée la lire, tout simplement parce que ça faisait longtemps. Dans la liste, stupéfaction, j’y trouve cette ligne.

Je n’ai jamais, jamais, de ma carrière, entendu parler d’un auteur qui avait reçu un cachet, aussi minime soit-il, pour une séance de signature en salon du livre. Les « invités officiels qui viennent de l’étranger », peut-être? Pour les autres, bien au contraire, une grande majorité défraient des coûts (transport, stationnement, repas, hébergement) pour être présents dans les salons. (note de transparence: ce n’est plus mon cas, mais je l’ai fait plusieurs années).
 “C’est de la promotion, tu vas vendre des livres”. Et c’est là que réside ma grande ambiguïté face aux salons. Depuis des années, je tente de percer le mystère de l’effet des salons dans le succès d’un livre, et la réponse m’échappe toujours. Pour chaque livre à succès dont l’auteur fait tous les salons, je trouve des contre-exemples dont l’auteur ne sort jamais de chez lui. Même chose pour les livres qui passent inaperçus, on en trouve des deux côtés de l’équation.
“C’est de la promotion, tu vas vendre des livres”. Et c’est là que réside ma grande ambiguïté face aux salons. Depuis des années, je tente de percer le mystère de l’effet des salons dans le succès d’un livre, et la réponse m’échappe toujours. Pour chaque livre à succès dont l’auteur fait tous les salons, je trouve des contre-exemples dont l’auteur ne sort jamais de chez lui. Même chose pour les livres qui passent inaperçus, on en trouve des deux côtés de l’équation.
Il est certain que la présence au salon fait vendre quelques livres, c’est indéniable. Mais est-ce que ces ventes font véritablement une différence? L’auteur seul à sa table n’a pas le même pouvoir que les centaines de libraires partout à travers la province. Alors, à chaque fois, je me pose la question qui tue: ne serais-je pas mieux de prendre toutes ces journées de présence au salon pour écrire un livre de plus?
Un livre complet contre des journées de salon peut sembler énorme, mais c’est que les salons se multiplient! Aux neuf gros officiels du Québec, il faut ajouter les plus petits qui poussent un peu partout (St-Hyacinthe, St-Basile), ceux hors province (Shippagan, Toronto) et ceux des écoles, et j’en passe.
 Parfois, l’équation est facile! Si le salon est jumelé à des animations scolaires payantes, on y va, le coeur joyeux. Le temps passé en séance de signature est alors compris dans le service et l’animation payée compensera le temps de non-écriture. Tout le monde est content.
Parfois, l’équation est facile! Si le salon est jumelé à des animations scolaires payantes, on y va, le coeur joyeux. Le temps passé en séance de signature est alors compris dans le service et l’animation payée compensera le temps de non-écriture. Tout le monde est content.
Mais une nouvelle tendance est de ne même pas payer les auteurs pour les animations en salon (honte à vous, salon de Montréal et de Longueuil! En Angleterre et en France, on vous couperait vos subventions !). Alors, je ne peux m’empêcher de me demander jusqu’où doit-on aller au nom de la fameuse visibilité?
Remarquez que je ne remettrai jamais en cause la question de si je dois faire des salons! J’en ferai toujours! Entre autres parce que j’adore ça, mais aussi parce qu’en plus de permettre des rencontres extraordinaires avec les lecteurs, elles permettent de converser avec son éditeur en face à face, de se faire de nouveaux contacts précieux, de se mettre à jour sur les nouveautés sorties, et bien plus encore.
Mais chaque fois qu’un courriel rentre pour me demander mes disponibilités, c’est la guerre dans mon cerveau entre mon désir de faire tout ce que je peux pour le succès de mes livres, et la peur de ne pas utiliser mon temps efficacement.
La question n’est pas « en faire ou non? », mais bien « combien de temps y consacrer »? Elle reste, pour moi, sans réponse encore aujourd’hui.
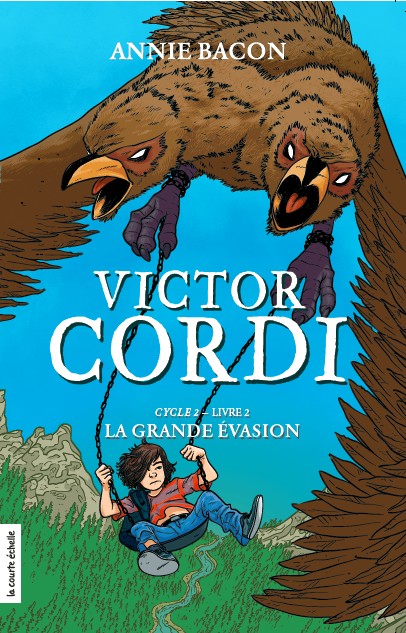












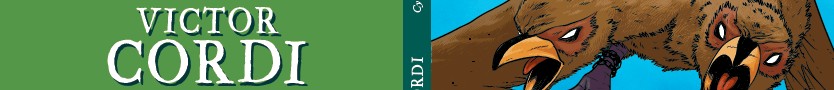

 “C’est de la promotion, tu vas vendre des livres”. Et c’est là que réside ma grande ambiguïté face aux salons. Depuis des années, je tente de percer le mystère de l’effet des salons dans le succès d’un livre, et la réponse m’échappe toujours. Pour chaque livre à succès dont l’auteur fait tous les salons, je trouve des contre-exemples dont l’auteur ne sort jamais de chez lui. Même chose pour les livres qui passent inaperçus, on en trouve des deux côtés de l’équation.
“C’est de la promotion, tu vas vendre des livres”. Et c’est là que réside ma grande ambiguïté face aux salons. Depuis des années, je tente de percer le mystère de l’effet des salons dans le succès d’un livre, et la réponse m’échappe toujours. Pour chaque livre à succès dont l’auteur fait tous les salons, je trouve des contre-exemples dont l’auteur ne sort jamais de chez lui. Même chose pour les livres qui passent inaperçus, on en trouve des deux côtés de l’équation. Parfois, l’équation est facile! Si le salon est jumelé à des animations scolaires payantes, on y va, le coeur joyeux. Le temps passé en séance de signature est alors compris dans le service et l’animation payée compensera le temps de non-écriture. Tout le monde est content.
Parfois, l’équation est facile! Si le salon est jumelé à des animations scolaires payantes, on y va, le coeur joyeux. Le temps passé en séance de signature est alors compris dans le service et l’animation payée compensera le temps de non-écriture. Tout le monde est content.